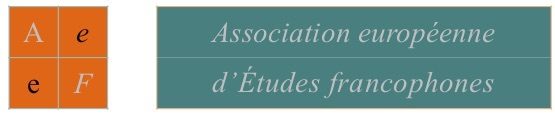Par Bertrand FONTEYN
L’enquête socio-littéraire du journaliste indépendant François Krug porte sur trois figures littéraires françaises de premier plan, Michel Houellebecq (1956 – ), Yann Moix (1968 – ) et Sylvain Tesson (1972 – ). Et plus particulièrement sur leurs liens personnels, voire idéologiques, avec l’extrême droite. Et il y a matière à décrypter ; si cette proximité paraît plus immédiatement évidente au sujet du premier, connu pour ses propos islamophobes et machistes, on peut se demander ce qu’un « écrivain du voyage » tel que Tesson vient faire dans ces parages. C’est qu’en effet, à l’instar du Rassemblement national en phase d’institutionnalisation, ces auteurs avancent masqués. L’étude de Krug se nourrit de nombreux contacts personnels, du dépouillage de la presse imprimée, d’émissions de radio-télévision, et bien sûr d’un matériau littéraire abondant. Elle se décline en treize chapitres suivant chronologiquement les itinéraires des trois protagonistes.
L’auteur entame son propos au début des années 1990, époque où une certaine droite réactionnaire a fait le constat d’une victoire de la gauche dans les esprits et tente de s’organiser pour y faire face. Krug décrit avec précision certaines stratégies littéraires et de réseautage, en mettant en exergue notamment la revue « Rive droite », ainsi que les rôles de Frédéric Beigbeder, de Thierry Ardisson et, surtout, de Jean-Édern Hallier. Il présente rigoureusement ce biotope réac, de même que les stratégies mises en place pour faire « monter les jeunes », notamment les premières contributions de Houellebecq dans « L’Idiot international » de Hallier, que le romancier à succès camouflera jusqu’au Cahier de L’Herne qui lui sera consacré en 2017.
À la rentrée 1989, Yann Moix, étudiant à Reims, distribue localement un fanzine négationniste intitulé Ushoahïa (en référence à l’émission de voyage animée par Nicolas Hulot ; notons que, plus tard, l’humoriste Dieudonné donnera aussi des déclinaisons de ce jeu de mots morbide), qu’il co-réalise avec son compère « Pichon ». Krug en détaille la genèse et en cite des extraits montrant que l’usage de l’humour – texte détourné de Nougaro, « poème inédit » attribué à Bernard-Henri Lévy – n’atténue en rien la violence ordurière du propos. Pour exemple : « Il n’y a jamais eu de camp à Vichy. Même Bernard-Henri Lévy, ce philosopheux coprophage post-soixante-huitard et sodomite sioniste, le reconnaît. Pourtant, ce dandy d’Ulm [BHL est un ancien élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm] au nez long, dont le crâne n’a pas été rasé par les amis d’Adolf à la grande joie de ses petits copains et de ses groupies boutonneuses, voit des camps partout. Tenez, demandez-lui : je suis sûr qu’à Vierzon ou à Saint-Germain-des-Fossés, il en a recensé un ou deux. Mais que vient-il nous endormir, le Nanar, avec ses juiveries prétentiardes et attardées de charognard pédophile puisque chacun sait que les camps n’ont jamais [souligné dans le fanzine] existé. » (cité en p. 47) On est loin de Desproges …
Mais, dès 1994, il se range au côté de BHL et intègre la liste des collaborateurs de la revue « La Règle du jeu ». Sans doute par hypocrisie et calcul carriériste car les amitiés troubles vont durer. En effet, en février 2004, lors de la première du film Podium avec Benoît Poelvoorde, dont Moix et Pichon ont écrit le scénario, le premier fait une nouvelle connaissance – Paul-Éric Blanrue, auteur d’une anthologie de propos antisémites et négationnistes dans laquelle Dieudonné et Alain Soral côtoient Balzac, Hugo, Zola, Freud, des gens étiquetés à gauche, de même que certains Juifs. La visée de cette anthologie est de montrer que l’antisémitisme est en fait généralisé ; Moix la préface en s’inscrivant contre l’antisémitisme. Soral republiera l’anthologie quelques années plus tard, mais sans la préface ; cette réédition sera attaquée par la Licra.
Ce même Blanrue lance en 2010 une pétition demandant l’abrogation de la loi qui condamne la contestation de crime contre l’humanité, dite loi Gayssot, et la relaxe de Vincent Reynouard, militant néo-nazi, négationniste et catholique intégriste qui, sous le coup d’un mandat d’arrêt européen pour violation de cette même loi, a finalement été arrêté à Bruxelles ; ex-professeur des écoles, Reynouard est le premier prof à se voir licencié de l’Éducation nationale pour négationnisme. Dans un premier temps cantonnée dans la fachosphère, cette pétition va gagner en visibilité quand Moix y appose sa signature, sous couvert de défense de la liberté d’expression. Le très controversé Jean Bricmont la signe aussi et se fait fort de récolter la signature de Noam Chomsky (ils avaient coécrit auparavant Raison contre pouvoir). Chomsky avait imprudemment signé une pétition de soutien à Robert Faurisson (1929-2018), le pape du négationnisme français, en 1979 ; il est plus prudent cette fois-ci, ne signe pas, mais apporte un message de sympathie à la demande d’abrogation de la loi Gayssot. Signent également Robert Ménard, l’ancien secrétaire général de Reporters sans frontières et maire extrême droite de Béziers, et Dominique Janet, l’ancien président de la BNF. Ce sont les deux fondateurs du site d’extrême droite « Boulevard Voltaire ». Au total, la pétition récoltera 970 signatures, dont celles de Dieudonné, François Brigneau (cofondateur du FN), des anciens du GUD (Groupe Union Défense). Yann Moix déclarera par la suite avoir été piégé par Blanrue, être contre le négationnisme ; il n’en demeure pas moins que c’est sa signature qui a fait connaître la pétition à un plus grand public. Un jeu trouble, donc, des positions non assumées publiquement.
Mais comme tout vient à point à qui sait attendre, la transparence se fera en 2018 au sujet du fanzine négationniste de l’époque de Reims. Après quelques mentions plus ou moins allusives sur certains sites de la fachosphère, dont Krug rend compte de façon très précise, il est fait mention du fanzine sur la page Wikipédia consacrée à Moix, mention retirée et rajoutée à plusieurs reprises. De quoi titiller la curiosité de « L’Express », qui publiera deux articles sur ce sujet et établira aux yeux du grand public la responsabilité de Moix, lequel fera des excuses publiques, exprimera des remords et sera finalement absous par BHL. Reste en outre une très grande proximité avec le chroniqueur d’extrême droite Éric Naulleau et une sympathie avec Geoffroy Lejeune, le directeur de la rédaction de « Valeurs actuelles », rencontré sur le plateau de Cyril Hanouna ; un petit monde qui fleure bon la droite extrême…
François Krug aborde le parcours de Michel Houellebecq en rendant compte, avec force détails d’agenda et documents de première main, des premiers contacts de celui-ci avec des jeunes royalistes de l’Action française (AF), en 1996, alors qu’il a 40 ans et que son premier roman a connu un succès critique certain, et notamment avec Sébastien Lapaque et Luc Richard, les fondateurs de la revue « Immédiatement », dont l’éditorial de lancement appelle de façon très populiste à rassembler les « anti-système » de tous poils. « Immédiatement a pour vocation d’exprimer la colère de ceux qui refusent d’entrer dans le paradis des robots. Cette colère est celle de royalistes mais aussi celle d’anars, de gauchistes, de libertaires, de réactionnaires, de républicains antidémocrates, celle de tous ceux qui refusent le prêt-à-penser, le bonheur obligatoire et le puritanisme des nouveaux bien-pensants. » (cité en p. 65) Le titre de cette revue est un emprunt au livre de Dominique de Roux (1935-1977), écrivain et éditeur, « aventurier littéraire », et fondateur des Cahiers de L’Herne, ainsi que de la collection 10/18. Il ressort de ces entretiens rapportés d’étonnantes remarques et un souci général de moralité de la part de Houellebecq, parfois perçu comme extrêmement cynique.
En 2002, alors devenu écrivain à succès, Houellebecq va donner un texte inédit mais disponible en ligne à l’occasion de la campagne pour l’élection présidentielle. Dans ce texte largement cité par François Krug, il annonce qu’il votera pour Jean-Pierre Chevènement car ce dernier veut fédérer des profils hétéroclites, et notamment des réactionnaires assumés. C’est alors que Houellebecq va commencer à faire sien publiquement l’argument du racisme antiblanc et à lancer des provocations et des insultes envers l’Islam, notamment dans la presse germanophone (à cette époque, il est très actif pour se promouvoir dans le monde germanophone – traductions, résidences, etc.).
En novembre 2010, Michel Houellebecq reçoit le prix Goncourt pour La Carte et le territoire. Nicolas Sarkozy l’invite alors à l’Élysée et Houellebecq choisit de s’y rendre accompagné d’un trio issu de la fachosphère, et notamment de Laurent Obertone, alors inconnu du grand public et de David Kersan, qui dirige le site www.surlering.com, ou plus simplement le Ring pour les initiés. Houellebecq se réfère souvent à ce site dans ses interviews, il dit le consulter souvent. Or qu’y retrouve-t-on ? Sous couvert de contre-culture plus ou moins trash, s’y côtoient un certain nombre de personnes très marquées à droite, notamment Renaud Camus, le père de la théorie du grand remplacement. Le Ring deviendra une maison d’édition en 2012 (jusqu’en 2021).
En 2017, après essuyé plusieurs refus, l’hebdomadaire « Valeurs actuelles », dont le directeur de rédaction Geoffroy Lejeune est devenu très proche de Houellebecq, obtient finalement une entrevue avec ce dernier qui fera même la une de ce numéro. Houellebecq remet le couvert l’année suivante, ce sont de nouveau une Une et, dans le corps de l’entrevue, des propos antimusulmans et dégagistes anti-gauche.
En 2019, c’est à l’intervention de Bruno Roger-Petit, le « conseiller mémoire » du Président Macron (et par ailleurs ancien journaliste proche de Pascal Praud, Cyril Hanouna, Geoffroy Lejeune), que Houellebecq doit l’obtention de la Légion d’honneur.
François Krug en termine avec la trajectoire de Michel Houellebecq au siège de l’Action française, à Paris, en juillet 2022, où il est l’invité d’une soirée littéraire qui lui est consacrée, sous le portrait de Charles Maurras (1868-1952).
Quant à Sylvain Tesson, Krug commence par en rappeler la réelle filiation avec Jean Raspail, notamment via le prisme de la littérature de voyage. Raspail est surtout connu pour son roman Le Camp des saints, paru chez Laffont en 1972 (par ailleurs année de fondation du FN), un classique de l’extrême droite auquel Tesson rendra un hommage explicite dans La Marche dans le ciel (1998), coécrit avec son compagnon de route Alexandre Poussin. Ces deux jeunes gens avaient reçu une bourse de la Guilde pour financer leur premier voyage à vélo autour du monde. Il s’agit d’une confrérie d’explorateurs et d’aventuriers fondée en 1967, et dont Tesson prend la présidence en 2018. À ce titre, il est amené à rédiger la préface d’un volume consacré à l’histoire de la confrérie, dans laquelle il passe sous silence des actions « coup de poing » de certains de ses membres très à droite et tord la rhétorique jusqu’au point de rupture. Ainsi écrit-il, au sujet du fondateur de la Guilde Patrick Edel : « Trop jeune pour la Résistance, il intégra un commanda de l’OAS. » (cité en p. 83)
Revenant sur les débuts de Sylvain Tesson, François Krug détaille sa courte carrière d’animateur radio, sur radio Courtoisie, où Tesson anime une émission consacrée au voyage et à l’aventure, émission précédée du message rituel qui la situe « dans le pays réel », une formule popularisée par Maurras. Le fondateur de cette radio, Jean Ferré (1929-2006), avait passé 12 ans dans l’Espagne franquiste, après la guerre d’Algérie, attendant la loi d’amnistie pour les soutiens de l’OAS et des généraux putschistes. Le père de Tesson, Philippe, était aussi journaliste et avait notamment assumé la fonction de rédacteur en chef du quotidien « Combat » de 1960 à 1974, période pendant laquelle ce journal accueillait volontiers la parole des partisans de l’Algérie française, toujours au nom de la liberté d’expression. La carrière de Sylvain Tesson décolle vraiment avec le succès de La Marche dans le ciel, qui compte aussi un pendant filmé diffusé sur France 3. Tesson prendra progressivement ses distances avec radio Courtoisie, notamment en signant chez Gallimard pour Dans les forêts de Sibérie (2011).
En 2021, suite à une soirée de soutien à la population du Haut-Karabagh organisée par l’association SOS Chrétiens d’Orient, proche de l’extrême droite notamment par la personne de son président de Meyer, assistant parlementaire de Thierry Mariani, Tesson parlera dans la presse de guerre de civilisations. Cette même année, il fera un retour à radio Courtoisie, en tant qu’invité cette fois, afin de promouvoir l’adaptation en BD de son récit Bérézina ; ce sera l’occasion de magnifier la culture russe et de nier la gravité de la covid.
François Krug mentionne également d’autres filiations intellectuelles de Tesson. Tout d’abord celle de Dominique Venner (1935-2013), figure mythique de la militance active et même terroriste de l’extrême droite, un proche du père de l’écrivain et à qui il rendra un discret hommage dans une colonne du « Figaro » en 2009. Krug analyse le corps de cette filiation, et notamment les divagations identitaires autour de la figure d’Homère qui exprimerait les dangers de l’universalisme et du multiculturalisme. À cela s’ajoutent les notions de paganisme, de puissance héroïque et de nature matriarcale, communes aux deux hommes.
Une autre proximité familiale et intellectuelle est celle de Jean Mabire (1927-2006), ami de Venner et du père de Tesson, écrivain d’extrême droite surtout connu pour ses livres sur l’histoire des SS, qui se trouvent dans la bibliothèque de Sylvain Tesson, aux côtés d’autres brûlots d’extrême droite que Krug détaille.
En outre, et pour compléter cet ouvrage en étoffant la description de l’infiltration de l’extrême droite dans le milieu culturel hexagonal contemporain, il nous paraît utile de regarder https://www.youtube.com/watch?v=c1g3z7KDil4&t=31s.